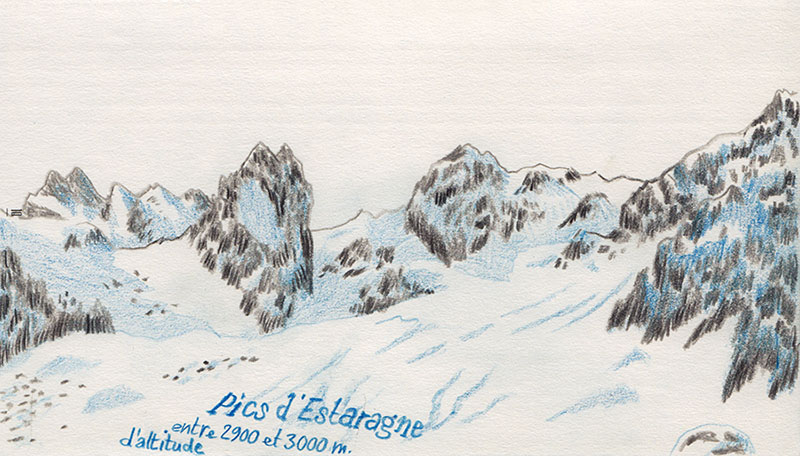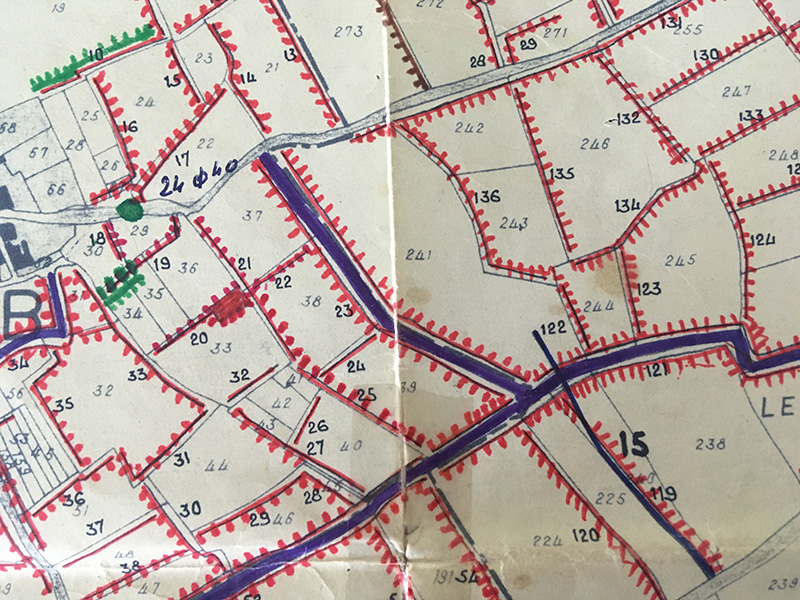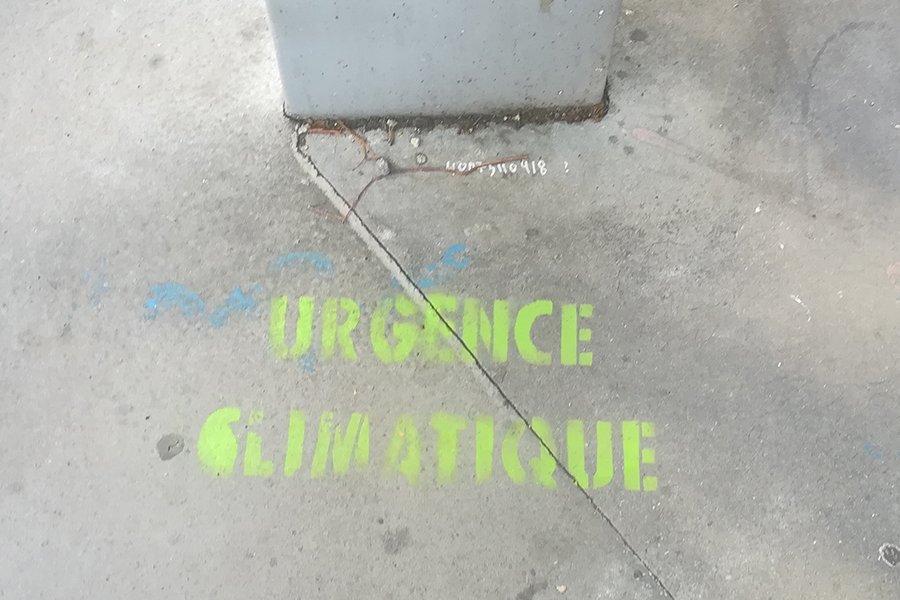Nice, mercredi 15 août, vers 11 heures et demi du matin.
Après une lessive complète de mes quelques affaires dans un lavomatic de l’avenue Borroglionne en compagnie d’Hector qui a un train à 13h45 pour Puget-Theniers où il va se détendre quelques jours dans un camping, je me retrouve seul, dans un tramway à destination de « Las Planas », terminus de la ligne dont j’ai supposé d’après le plan qu’il permet d’accéder à une bretelle d’autoroute. Objectif : joindre Strasbourg en stop avant dimanche en passant par le lac de Côme et la Suisse.
Alcide, Antigone et Hérodote nous ont laissé tout à l’heure près de la gare des chemins de fer de Provence, sur le grand parking de l’Intermarché. Nous avons avant cela randonné quelques jours entre Sospel et San Remo, puis erré un peu sur la côte, autour de Menton. Pendant le séchage de nos affaires, Hector, pensant manifestement que mon voyage serait riche en relations humaines, m’offre un petit livre intitulé « Les 100 choses à savoir sur le sexe quand on est un homme », avec cette dédicace : « Tout se passe sur les parkings, bonne route Paul.». Je n’ai pas le cœur de lui avouer que le but de mon voyage, si tant est qu’il en ait un, n’est sûrement pas de faire des rencontres. Il n’y a pas de but, je me laisse entraîner par une envie impérieuse de nomadisme solitaire.
Arrivé à Las Planas, au bout du tramway, je n’ai aucun mal à trouver l’accès vers l’A8 direction Monaco et l’Italie et je me place à l’endroit qui me parait le moins pire pour lever le pouce, entre le dernier rond-point avant l’autoroute et un bas côté assez spacieux pour qu’un véhicule s’y arrête, s’il m’aperçoit avant d’avoir pris trop de vitesse. Ce n’est pas la première fois que je fais du stop, et mon expérience me laisse à penser que le spot n’est pas bon, mais qu’avec un peu de chance, je serai parti dans les deux heures.
Déjà une heure d’attente pendant laquelle j’ai observé le comportement des automobilistes, certains agitant les mains pour me signifier que l’endroit n’est pas adapté pour un arrêt. L’art de l’autostoppeur est avant tout d’optimiser les chances d’être pris rapidement, et l’endroit me paraît de plus en plus défavorable. Il fait par ailleurs une chaleur accablante, il n’y a pas d’air et il n’est pas question de lambiner à l’ombre. Vers 14h30, presque rôti sur cet échangeur routier entouré de hauts immeubles blancs dont les stores tirés au maximum rappellent que le moment se prête d’avantage à la sieste, je décide de lever l’ancre. L’endroit commence à me filer le bourdon. Je me mets à marcher le long de l’autoroute, sur une étroite bande de l’autre côté de la glissière de sécurité, dans l’idée de rejoindre la prochaine bretelle qui ne peut être que plus favorable. Après une centaine de pas craintifs et une dizaine de coups de klaxon appuyés, je me rends compte que le soleil m’a probablement fait perdre un peu de lucidité et que je ne parviendrai pas vivant à la prochaine sortie. Le bas-côté sécurisé n’est pas continu sur cette portion de l’A8, et l’obligation de franchir (chose inenvisageable) un tunnel avant d’arriver à la bretelle de Nice Est m’oblige à quitter en vitesse mais non sans mal ce territoire fortement hostile qu’est une bande d’arrêt d’urgence.
En bas d’un talus assez vertigineux d’au moins 15 mètres de dénivelé sur une pente à 45°, j’atteins par l’arrière le fond d’une impasse et débouche sur l’avenue Henri Dunant.
Nice Nord. Un archétype de faubourg contemporain avec des barres d’immeubles un peu glauques, des voitures pas très fraîches sous des platanes poussiéreux, et un parfum de petite misère sous la torpeur estivale. A un abribus où je consulte le plan de la ville, un homme me conseille de prendre le tramway dans l’autre sens pour gagner la bretelle Est. Mon moral déjà diminué en prend un sérieux coup car je dois repasser par le centre ville que j’ai cru quitter définitivement il y a trois heures. Il me faut de surcroît reprendre le tramway en sens inverse, et je me dis que vraiment c’est un faux départ monumental et honteux.
Vers 16 heures, je suis posté sur la bretelle Est. Techniquement, l’endroit se prête parfaitement à la pratique de l’autostop. J’ai pu refaire le plein d’eau dans les toilettes du Mac Do qui bien sûr occupe un coin de rond-point et dont la climatisation tourne à plein régime. Le chaud froid est violent lorsqu’on passe la porte après la fournaise de l’extérieur.
Je me sens mieux. Peut-être est-ce grâce au choc thermique, ou peut-être est-ce l’effet secondaire du petit vent de liberté que j’ai ressenti quelques minutes auparavant en marchant jusqu’ici depuis la station Pont Michel ? Cela n’a pas duré longtemps, juste une minute ou deux. Une agréable sensation de toute puissance accompagnant le léger frisson d’excitation que connaît le voyageur solitaire en début de périple. Rafraîchi et rasséréné, me voilà donc tendant le pouce avec une toute nouvelle ferveur. J’en profite pour perfectionner ma pratique de la technique fondamentale de l’autostoppeur chevronné qui consiste à capter systématiquement le regard des conducteurs et des conductrices, afin de leur adresser un sourire respectivement complice et charmeur. Parfois ô miracle, je saisis en retour le sourire gêné d’une automobiliste timide. Mon esprit naïf transforme immédiatement le sourire gêné en un sourire charmé voire séduit, et c’est une douce consolation lorsque la voiture continue sans s’arrêter. Parfois, une vraiment jolie ralentit un peu, semble hésiter, évidemment tiraillée par deux réflexes antagonistes : d’un côté les préceptes familiaux et sociétaux qui découragent toute femme seule de s’approcher d’un homme sur le bord d’une route, et de l’autre l’envie pressante de faire monter le jeune aventurier au si beau sourire.
18 heures 20, je viens de monter dans ma première voiture. Je commençais à ne plus y croire, mais voilà que ça y est, je suis parti. Mon chauffeur se rend à Sospel, nom qui me renvoie immédiatement une semaine en arrière, au départ de notre randonnée. Il en faut peu pour réveiller ma lourde tendance à la mélancolie et je déteste en particulier ce genre de situation qui fait d’un ancien départ une arrivée. Mais cet état d’âme est vite oublié car je peux enfin converser avec quelqu’un. C’est un artisan au volant de son utilitaire, rentrant de Nice où il a passé la journée en famille comme tout un chacun en ce 15 août. Il quitte l’autoroute à l’embranchement de Menton et je lui demande de m’y laisser.
Là, sous le grand viaduc autoroutier, j’assiste à un départ de feu de forêt juste sur le versant d’en face. Une colonne de fumée blanche s’échappe de sous les arbres dans un quartier résidentiel. Des camions de pompiers passent à vive allure devant moi en direction du sinistre. En quelques minutes, plusieurs hélicoptères sont déjà sur place et tournoient autour de la colonne. J’assiste avec une joie d’enfant à la ronde de largages d’eau et de produits retardateurs. De là où je suis, je distingue presque le réservoir où ils s’approvisionnent en eau, sur un flanc de la montagne.
19h30, personne ne s’est arrêté, je ne dormirai pas en Italie ce soir, et me voilà à trois kilomètres de Menton où j’étais il y a trois jours. Mon optimisme retombe. Je décide quand même de rejoindre la ville à pied même si cela m’éloigne de l’autoroute. Cette après-midi fût la pire de mon expérience d’autostoppeur, j’estime avoir largement le droit à une compensation et je ne vois qu’un établissement gastronomique pour oublier ma rage. Je décide de prendre le chemin de toutes ces maudites voitures dont les conducteurs, tous heureux de trouver un prétexte pour ne pas s’arrêter, m’ont fait signe qu’ils tournaient à gauche, et que j’ai vu à chaque fois prendre en effet la direction d’un certain « couvent de l’annonciade », par une route qui monte sur le haut du relief. Le trajet par ce chemin s’avère pénible, chaque virage rendant plus maigre l’espoir de tomber sur un hameau plein de charme avec un bon petit restaurant et une fontaine d’eau claire. Je finis par arriver au dessus de Menton, et j’emprunte le chemin du Rosaire qui y descend.
Environ 20h30. Je suis attablé à la terrasse d’un restaurant italien de l’avenue Boyer, après avoir enfilé un T-shirt propre. Sans aucun scrupule je commande un demi pichet de rosé et une assiette de pâtes fraîches al arrabiata ou quelque chose de proche. « Bon choix » me dit le chef de service, une caricature d’italien avec chemise ouverte, cheveux dans le vent et discours volubile. Je le soupçonne d’avoir dit cela par pur esprit commercial, mais je dois avouer une fois le plat servi que c’est réellement bon, et que les pizzas dans la plupart des autres assiettes n’ont pas l’air terrible. A ma gauche, un couple de vieux quadragénaires (peut-être de jeunes quinqua) semble manquer de sujets de conversation. Les silences sont pesants même pour moi. A ma droite un italien solitaire et visiblement déprimé fait une moue désabusée en écoutant les propositions du serveur. Le chef caricatural est appelé à la rescousse et accoure en préparant son numéro. Comme par magie, la conversation en italien redonne de l’entrain au client déprimé. Il commande un demi pichet de rouge et une pizza disons « sur mesure » car je crois qu’il a des requêtes précises quant à sa composition.
Environ 23h. Un peu grisé par le vin et la grappa, je marche sur l’avenue en direction de l’autoroute. Entre les deux chaussées de circulation, il y a une sorte de parc linéaire avec une allée sinueuse que j’emprunte, cherchant un coin discret pour m‘allonger et dormir. Je finis par poser mon sac dans un léger renfoncement de massif, et m’y endors rapidement.
Jeudi 16 août.
Tôt le matin, des solitaires en survêt (mais on les croirait en pyjama) promènent leurs chiens dans le parc et cela achève de me réveiller, la pluie intermittente de l’arrosage automatique ayant déjà fait irruption dans mes rêves troubles. J’ai terriblement besoin d’eau et d’un café, alors je me résous à marcher jusqu’au parking de l’Intermarché près de l’échangeur, où je sais qu’il y a un bistrot puisque nous nous y nous étions arrêtés. « Tout commence sur les parkings » me dis-je.
En mangeant mon petit déjeuner je constate avec une certaine satisfaction que l’incendie de la veille fait la une de Nice Matin. Cette nouvelle semble presque justifier la galère de l’après-midi, comme si j’avais été retardé spécialement pour pouvoir assister à l’évènement. Serein et presque guilleret, je me mets en route vers 9h30, et en moins de cinq minute, une camionnette s’arrête pour me faire monter. C’est encore un artisan, à la retraite cette fois-ci, qui se rend à Vintimille pour y faire certaines courses. Il me pose au péage après la frontière. Enfin en Italie.
Pas plus de cinq minutes plus tard, un camping-car se gare devant moi et un couple de jeunes italiens m’accueille à bord. Je ne parle pas l’italien mais la jeune fille, qui porte un short en jean très court, parle bien français. Ils ont passé leurs vacances en Espagne et rentrent dans la région de Venise où ils habitent. Le garçon, tenant le volant, m’assure via la traduction de sa compagne que l’autostop est interdit sur les autoroutes italiennes. Il propose de me poser à une gare mais je préfère lui dire que je vais réfléchir au problème. La configuration spatiale rend la conversation difficile, eux dans la cabine avant et moi derrière, d’autant que mon sommeil de la nuit n’a pas été réellement réparateur. Je finis par m’assoupir la tête posée sur mon bras lui-même posé sur la table du camping-car. Lorsque je me réveille nous sommes au niveau de Gênes. Je me mets à observer l’intérieur du véhicule où règne un léger désordre. Vêtements froissés, matériel de cuisine, de plongée, jeux de société… Rien de très excitant. Je m’entretiens alors avec mes hôtes ambulants et leur demande de me poser à Piacenza où je pourrai continuer vers Milan. Je prends le risque de continuer en stop. Le camping-car continue sa route, nous longeons la vallée de la Scrivia puis arrivons dans la vaste plaine du Po. Par la fenêtre, le paysage agricole est tel qu’il m’était apparu lorsque j’y étais passé quelques années auparavant, avec ma famille. D’immenses champs de céréales dont beaucoup de maïs interrompus ça et là par des bandes étroites de peupliers et de robiniers, de grandes fermes semblant parfois abandonnées, bref une plaine monotone et peu hospitalière si l’on en croit ce que l’on voit depuis l’autoroute.
Sous le soleil brûlant de 14h, je descends du camping-car sur un rond-point à l’ouest de Piacenza (« Plaisance » en français). Je déjeune, à l’ombre d’un vieux mûrier, de pain et de jambon arrosés de vin rouge. Ensuite c’est encore une longue et vaine attente, en plein cagnard, devant un panneau indiquant « no autostop ». Malgré mon espoir, point d’anarchiste ou d’esprit subversif pour braver l’interdit, point non plus d’âme compatissante pour me tirer de ce bord de route à l’herbe jaunie et au bitume liquéfié par la canicule.
A 15h30 je décide de rejoindre la gare. Un pompiste m’indique le chemin : cinquième rond-point à gauche, puis tout droit pendant trois ou quatre kilomètres. Au total environ cinq ou six kilomètres. Je me mets en route, content de retrouver de l’action.
Après les cinq ronds-points, je prends à gauche et longe les remparts de la cité de Piacenza : une fragile muraille de briques usées, d’une argile rouge paraissant rose pâle sous la lumière blanche de l’astre déchaîné. Le chemin indiqué contourne donc le cœur de ville pour rejoindre la gare qui doit se situer en bordure de la cité, plus probablement à l’extérieur de l’enceinte.
Quand j’arrive enfin dans le hall de la gare, je tombe sur un plan de la ville qui m’apprend que le pompiste (peut-être une déformation professionnelle) m’a conseillé un itinéraire destiné à un automobiliste pressé qui aurait souhaité rejoindre la gare au plus vite. Il m’aurait suffit au cinquième rond-point de continuer tout droit et de traverser ainsi le centre ville ce qui m’aurait évité en plus, la pénible marche le long de la rocade. Au buffet, complètement désert, j’attends une demi heure avant que la serveuse m’apporte une Peroni. Après l’avoir engloutie, je monte dans un train pour Milan rempli d’une joyeuse foule qui parle fort.

19h environ
Après l’effroyable début d’après-midi sous le cagnard de Piacenza, le trajet en train avec son escale trouble et sonore dans la gare centrale de Milan m’a plongé dans une douce fatigue, je rêve à la fenêtre du train. Le ciel à l’ouest passe au rose alors que train prend légèrement de l’altitude.
L’arrivée en gare de Côme se déroule en léger surplomb. Le convoi ralentit et, entre les troncs des immenses sapins, on voit de plus en plus distinctement le tiède éclat de la ville sous les rayons rasants du soir. Des façades roses qui roussissent, des tuiles qui cramoisissent. La gare de Côme, immense et sous-peuplée, semble construite dans une clairière, au-dessus de la ville. Je demande un plan à un guichetier moustachu qui m’envoie bouler parce que je m’adresse à lui en anglais. Sans plan, je quitte le hall et me dirige droit vers l’est. Il y a une sorte de parc devant la gare. On descend vers la ville à travers les arbres, et on tombe immanquablement sur une immense main en pierre dont les doigts disproportionnés les uns par rapport aux autres vous laissent un bizarre sentiment de dégoût.
J’arrive sur la piazza Cavour après quelques pas rapides dans des rues larges à gros moellons de pierre. L’architecture me paraît massive et quelque peu grossière, à mi-chemin entre la grâce équilibrée des palais italiens et l’austérité brutale d’une station de sports d’hiver. Il n’y a pas de plage proche de la vieille ville. Il y a un port de plaisance, mais aucun aménagement pour accéder à l’eau. Je demande à un jeune couple s’il y a une ‘piaggia’ ou un ‘bagno’ à proximité. Ils semblent étonnés et me conseillent sans conviction de marcher vers le nord par la rive ouest. Me revient alors l’avertissement d’Hérodote selon qui il y a très peu voire pas de plage publique au bord du lac, ses rives étant quasi exclusivement détenues par les propriétaires de maisons avec plages privées. Tout de même sceptique sur cette théorie, je décide de marcher sur la rive ouest pour essayer de trouver enfin un bout de plage et piquer une tête. Trois cent mètres de quais sont en chantier, inaccessibles à moins de franchir une haute barrière opaque en métal. Ensuite je m’engage sur le « lungolago Mafalda di Savola », qui signifie « promenade Mafalda de Savoie ». Un panneau à l’entrée m’apprend que Mafalda était la fille du roi Victor Emmanuel III d’Italie et d’Hélène de Monténégro, qu’elle fût soupçonnée (peut-être à raison) par Hitler d’avoir empoisonné le roi de Bulgarie, et qu’elle périt sous les bombardements américains en 44 à Buchenwald.
Un peu fourbu, je continue de marcher le long du lac tandis que les hauts versants montagneux s’allument progressivement de mille lampadaires. Toujours pas de plage. Entre chien et loup, les montagnes basculent dans un état transitoire. On a l’impression que leurs masses augmentent tandis qu’elles deviennent de plus en plus sombres, d’autant que le ciel à l’horizon paraît clair comme il ne l’est jamais en pleine journée. La présence des montagnes s’étend et finit par tout dominer.
Sans conteste, il y a quelque chose de magique en ce lieu. On pourrait penser qu’il fût spécialement conçu par le Grand Architecte, aidé des petits, afin de créer une émotion supérieure. Pour ma part je crois que l’émotion vient de la manière des hommes d’habiter les berges du lac. A la pointe aval, la ville, sa place Cavour ouverte sur le port, sa promenade éclairée. Puis le long des rives, une myriade de maisons pour la plupart dissimulées dans la végétation. J’imagine le lac dans son entièreté, s‘étirant sur une cinquantaine de kilomètres vers le nord-est, parsemé de petites agglomérations qui occupent et colonisent par grappes, les versants accessibles.
En pleine jubilation, je décide de m’asseoir sur un banc pour manger avant de trouver un coin pour dormir. Un banc ?
LE banc. Le banc du siècle ! Donnant à voir un panorama proche de la perfection pittoresque. Tout à ma gauche, un cyprès, verticale nécessaire pour tout premier plan un tant soit peu romantique, puis en allant vers la droite, la surface pâle du lac, disparaissant au loin derrière un pan de montagne, reflétant en son centre la dernière clarté du ciel et sur ses franges les premières lueurs nocturnes qui s’installent sur les pentes. En face de moi un funiculaire illuminé relie d’un trait la berge et la crête sur le versant le plus proche. Il y a un bâtiment tout en haut, probablement un restaurant. A ma droite tout au fond, les palais de la place Cavour coiffés du dôme de la cathédrale, plein de lumière.
Je sors de mon sac les victuailles pour le festin.
Comme si rien ne pouvait assombrir le tableau, le jambon est italien, le pinard du Ventoux et le pain admirable, notamment tartiné de fromage blanc crémeux. Le lieu et les quelques feuilles de roquette transforment ce bon gueuleton en une expérience de haute gastronomie. Je me sens joyeux, puis peu à peu carrément euphorique, et j’atteins enfin un sentiment de toute puissance et de profonde liberté. Est-ce le vin ? Non il y a beaucoup plus ; la solitude ? Un peu sans doute ; le lieu ? Oui manifestement.
Je m’étale sur le banc en grignotant des biscuits, et la jubilation est si totale, que si une superbe italienne habillée d’une robe obscène s’amenait là pour me proposer oun péti café ‘ristretto’ pour accompagner ça, je crois que je ne serais pas tellement surpris. Le ciel est à présent presque complètement noir, toutes les étoiles ont fait leur apparition. Depuis les rives toutes éclairées du lac, les lignes de réverbères le long des routes rejoignent des constellations de maisons éclairées perchées dans la montagne. Sans faire attention on pourrait vraiment les confondre avec les constellations d’étoiles, mais la texture de la montagne est d’une noirceur plus épaisse que la nuit. Les biscuits à l’anis et le clapotis de l’eau ramènent mon esprit au calme.
La promenade Mafalda de Savoie est un endroit fréquenté jusque tard dans la nuit. Des personnes seules qui promènent un chien, des couples avec leurs enfants en balade du soir, mais surtout des couples d’amoureux et je me rends compte que je ne dois pas être le seul à avoir identifié l’endroit comme un haut lieu du romantisme.
Un couple d’environ 70 ans qui se draguent. La dame fait des chichis comme une demoiselle de 17 ans, mais avec un surplus de technique dû à l’habitude et au recul de son âge. L’homme est insistant et je crois qu’il joue sur l’idée de profiter de la vie, qu’il tente de la convaincre qu’il est évident que tous deux ont envie de la même chose : passer un bon moment de tendresse, profiter de la vie. Un peu plus tard ils repassent et la dame n’a pas encore cédé, mais lâche un peu de lest en se laissant un bref instant embrasser dans le cou. Ah ces italiens !… En revanche beaucoup de jeunes couples marchent sans rien dire, dans un malaise que je sens palpable, comme un souffle d’asphyxie, à chaque fois qu’ils passent à hauteur de mon banc.
Il y en a aussi qui viennent pour s’engueuler, comme si la douceur de l’air et la tranquillité de l’eau allait rendre cette tâche moins pénible. D’autres ont l’air de faire le point sur leur vie, parler de leurs soucis. Cette fois-ci réellement ivre, je me dis que j’ai vraiment eu de l’instinct pour m’asseoir là sans vraiment y réfléchir. C’est un lieu majeur, sans doute le vrai centre de gravité de la ville.
Deux cent mètres plus loin je trouve une superbe pelouse bordée de cyprès au pied d’un monument de pierres qui fait écran aux vues depuis la route. Le coin idéal pour dormir au bord du lac. Pas besoin de planter la tente, le temps est au beau fixe.

Vendredi 17 août
Au bord du lac devant le monument il y a un quai. Dans ce quai il y a deux dents creuses comme des alcôves avec des marches de pierre qui descendent dans le lac. Au soleil du petit matin, je pose des vêtements propres sur les marches du haut et accède à l’eau claire pour faire un brin de toilette. L’enchantement de la veille ne s’est pas arrêté avec la nuit. Comment mieux commencer une journée ?!
Plus tard, assis à la terrasse d’un café près d’un hangar à hydravions, j’observe les mécanos qui sortent les coucous et commencent à les préparer. Je ne peux m’empêcher de penser à Tintin, et même si les appareils que je vois me rappellent celui du Crabe aux pinces d’or, je me dis que ma situation géographique correspond assez à l’affaire Tournesol. Bientôt l’un des avions est dans l’eau, le moteur à hélice est lancé et l’embarcation se met à avancer. Après au moins 500 mètres d’accélération, l’hydravion décolle. On entend le ronronnement du moteur qui se propage doucement dans l’air déjà tiède de la vallée, même longtemps après qu’il ait disparu entre les montagnes.
Je me dirige ensuite vers la ‘via Borgho vico’ qui part en direction du nord-ouest, car j’imagine qu’elle permet d’accéder à l’autoroute pour la Suisse. Personne ne s’arrête mais cela ne ternit nullement mon enthousiasme. Les villas que je croise dans la montée me font irrémédiablement penser à celle du professeur Topolino, le collègue Suisse du professeur Tournesol, spécialiste des ultrasons. J’arrive après une bonne demi-heure de marche à un cul-de-sac et je dois me résoudre à avouer mon erreur de navigation. A ce moment précis, un homme sort de sa maison et m’aperçoit avec ma mine déconfite. Il m’interpelle et je finis par comprendre qu’il propose de m’emmener à l’autoroute. L’italien parlé sans trop d’accent et pas trop vite est compréhensible dans les grandes lignes, surtout que les gestes des mains accompagnent chaque idée. Je finis par m’étonner moi-même car j’arrive à tenir une conversation à peu près cohérente. Mon chauffeur m’emmène en fait jusqu’à Lugano en Suisse, il s’y rend pour acheter quelque chose comme des tubes de cuivre. Nous passons la frontière à Chiasso puis, après Mendrisio, nous arrivons en vue du lac de Lugano. L’autoroute franchit le lac sur une langue de terre. Ca y est, j’ai vraiment l’impression d’avancer, rien ne peut me ralentir, et il fait un temps splendide.
A Lugano, un macédonien dans un 4X4 BMW s’arrête et m’emmène vers Bellinzona. Il me dépose au milieu d’un échangeur pour que je puisse partir en direction de Bâle. Là c’est un suisse germanophone au volant d’un 4X4 Jeep qui s’arrête courageusement en pleine bretelle. Il rentre chez lui, du côté de Bâle. Son accent est très fort, je ne comprends presque aucun mot. J’ai pourtant étudié l’allemand, même si je n’ai jamais réussi à baragouiner plus que quelques phrases apprises par cœur pour le bac. Cependant après quelques minutes d’adaptation, lui persistant sans relâche à me parler dans sa langue (il ne parle pas un mot d’anglais), je finis par construire quelques phrases à peu près correctes quoique sans intérêt. La route suit en montant le fond d’une large vallée, celle de la Ticino, qui alimente le lac majeur. Le paysage devient de plus en plus montagnard, se réduisant peu à peu à des pentes très raides, herbeuses dans le bas, portant ça et là des bois de sapins, des fermes et des hameaux, avec ces chalets qu’on voit sur les images d’Epinal.
Nous approchons du col du San Gottardo (Saint Gothard en français). Mon chauffeur m’informe qu’il y a toujours un embouteillage avant l’entrée du tunnel qui permet de l’éviter. La route par le col est plus longue d’une demi heure mais il propose de l’emprunter car il pense que cela peut me plaire…
Le ruban d’asphalte escalade en lacets la pente vertigineuse du San Gottardo. Dans certaines boucles, la route est construite en porte-à-faux pour optimiser la vitesse des véhicules qui l’empruntent. La montée est tout simplement époustouflante. Beaucoup de pilotes diplômés et du dimanche, amateurs de belles mécaniques, viennent ici spécialement pour s’offrir soit une ballade sympa, Ray-Ban et cheveux au vent, soit une bonne bourre avec les copains avant l’apéro, Ray-Ban toujours, mais cheveux gominés… Un peu avant d’arriver au replat du col, on aperçoit en contrebas l’ancienne route de pierre, entièrement pavée, qui gravit à sa vitesse, donc avec beaucoup plus de lacets, la pente herbeuse de la montagne.
Au col, il y a un grand parking, et quelques bâtiments austères. L’herbe est un peu moins verte, c’est plutôt tourbeux en fait. Nous nous garons, le chien se trempe en rechignant un peu dans une mare qui doit regorger de libellules rarissimes et de tritons non moins exceptionnels. Impossible de trouver un sujet de conversation simple pour briser le silence. Mon allemand et son anglais sont abominables.
Nous repartons pour la descente et stoppons bientôt devant une petite guérite posée sur un renfoncement au bord de la route. Mon chauffeur propose de déguster un morceau de fromage local, des meilleurs semble-t-il.. Le vendeur est tellement blond qu’il serait refusé pour une pub de Kinder. En revanche il conviendrait à merveille dans un James Bond pour le rôle d’un autrichien fou et mégalo niché dans sa forteresse alpine. Le fromage vaut effectivement le détour. J’en achète un morceau. Lui s’en paye une meule.
Dans la vallée d’Andermatt, au cœur des plus hauts sommets des Alpes, l’herbe est en ce mois d’août caniculaire d’un vert éclatant. Observant à travers la vitre la vaste prairie qui occupe toute la partie basse de la vallée, j’aperçois stupéfait des femmes et des enfants occupés à faucher à la main de petites parcelles carrées discrètement délimitées par des clôtures amovibles. Une vision d’un autre temps qui me laisse rêveur jusqu’à la descente finale par la vallée de la Reuss. La route moderne y est abritée sur presque toute sa longueur d’une chape de béton enherbée qui la protège des avalanches. C’est une véritable route galerie qui serpente sur le flanc de la montagne. La surface pâturable est restituée, voire augmentée. J’aperçois le lac de Lucerne. Sur les rondes collines qui l’entourent, les prairies bien grasses sont parsemées d’arbres fort distants les uns des autres et disposés sans aucun ordre apparent. Il y a des fruitiers mais aussi d’autres espèces, et de petits bosquets de sapins. Très distinctes, les forêts à dominante résineuse occupent les hauts. J’avais toujours imaginé la Suisse austère et rocailleuse. Je trouve un moutonnement de montagnettes verdoyantes, abritant dans leurs creux des lacs bleus outremer.
La température dans la voiture est frigorifique, la clim tourne à fond de balle, cela devient difficile à supporter. Je souffre mais je me dis que cela vaut peut-être mieux ainsi étant donné l’odeur du chien mouillé qui parvient par vagues à mes narines. Ces circonstances, s’ajoutant au sentiment d’une traversée beaucoup trop rapide de la Suisse, m’amènent à demander à mon chauffeur de me poser à Lucerne, même si mon intention était de joindre Bâle le soir. Il me dépose près de la gare. Je marche un peu, m’achète du pain avec un billet de 20 euros et obtient ainsi des francs suisses : environ 25. J’ai faim, il est presque 15h. Je m’attable au bord de l’eau à l’endroit où le lac, retenu par un barrage à aiguilles, redevient la Reuss, un torrent limpide, rapide et bleu turquoise. Je commande de la saucisse avec des patates, de la salade et une bière. Les nappes sont roses.

Après mon repas je traverse la Reuss par l’un des ponts galerie qui relient les deux rives. Je déambule un peu déçu dans les vieilles rues et surtout étouffé par la chaleur et par la foule de touristes qui déborde des magasins de souvenirs. Mes pas me guident vers l’extérieur de la ville et je décide de retraverser le torrent pour avancer sur ma route vers Bâle. Le courant est rapide. Un panonceau accroché au pont suivant indique par un symbole clair que la baignade est interdite. Cela me fait sourire car jamais il ne me serait venue l’idée de m’aventurer dans ce tumulte, d’autant que les berges sont soit verticales, soit très abruptes. Je marche le long d’une rue assez sombre qui traverse un quartier indien. Vers 17h je me rends compte qu’il est trop tard pour avoir une chance d’arriver à Bâle ce soir, et je me ravise donc, rebroussant chemin afin d’acheter quelques victuailles pour la soirée. Trainant un peu sur la berge, mon attention est soudain captée par un mouvement suspect. Une dame s’est jetée tranquillement dans la rivière depuis la rive d’en face, et s’offre le luxe de quelques lents battements de dos crawlé tout en se laissant emporter par le courant qui je l’ai dit, est fort rapide. Environ 3 mètres par seconde. Je repense au panonceau du pont. Fichtre… me dis-je en la regardant s’éloigner rapidement vers l’aval.
La nageuse remonte sur la berge par une échelle qu’elle a saisi au vol une centaine de mètres plus bas. Elle attrape sa serviette suspendue à une branche, et s’éloigne en se séchant mollement, comme si elle venait simplement de piquer une tête dans la piscine de son jardin. Bluffé par l’audace nonchalante de la nageuse, je décide d’essayer au plus vite d’en faire autant. Il me faut d’abord de la boustifaille car les magasins vont fermer. Cette formalité remplie, je rejoins l’endroit où j’ai vu la dame sortir de l’eau. L’échelle est bien là, sous un grand saule pleureur. Après une vague hésitation, mon maillot de bain est enfilé et je passe sous la rambarde pour me poster sur le fameux rocher qui permet d’entrer doucement dans l’eau. Elle n’est pas aussi froide que je l’attendais. Hop ! C’est parti, je me jette, le courant m’emporte et je me rassure en mesurant l’influence de mes mouvements de brasse sur ma trajectoire. Elle est faible et lorsque je m’approche du centre du torrent, la où le courant est le plus fort, je comprends immédiatement qu’il vaut mieux rester près du bord. Le saule approche à vive allure, je nage vers l’extérieur, saisis l’échelle et remonte sans tarder. L’expérience est fort agréable, je recommence plusieurs fois avant de me lasser.
20h, le soleil décline à l’ouest, je me suis trouvé un coin pour passer la nuit, juste au dessus d’une voie rapide relativement peu fréquentée. J’ai monté la tente sur un carré d’herbe qui surplombe l’entrée d’un tunnel. C’est ce que l’on appelle typiquement un « délaissé urbain » dans le jargon de ma profession. Je suis plutôt content de mon choix car le panorama est assez complet : l’enceinte de la vieille cité (un peu de vieille caillasse ça ne peut pas faire de mal), le centre ville au bord du lac avec les montagnes au loin, la voie rapide peu fréquentée qui marque la limite avec les faubourgs, le quartier indien, et au premier plan, depuis les ponts galerie jusque tout à ma droite, le flot tumultueux de la Reuss. Tout en débouchant une bouteille d’un excellent vin suisse, j’observe quelques jeunes gens qui s’amusent dans le cours d’eau à l’endroit même où je me suis baigné. Ils essayent de surfer tant bien que mal sur une planche à l’aide d’un wishbone qu’ils ont attaché à un câble d’une centaine de mètres relié à la rive. En se laissant dériver progressivement pour tendre le câble, il semble possible de se mettre debout. Là il s’agit de jouer avec les jambes pour glisser latéralement et garder le câble tendu le plus longtemps possible.

Samedi 18 août
La journée du 18 commence sous d’excellents hospices. Grand soleil, charmant petit déjeuner dans une boulangerie-café-terrasse des faubourgs, puis marche sereine pour gagner la voie rapide vers le nord. La suite cependant n’est pas aussi glorieuse. Après quelques sauts de puce laborieux entre Lucerne et la région d’Olten, je me retrouve coincé sur une aire d’autoroute, à la sortie d’un gigantesque parking vide. Et toujours une chaleur à crever. Je capitule vers 14h et me dirige vers le bois sous lequel sont installées des tables de pique-nique. En cassant la croûte, je réserve avec le peu de batterie qui me reste sur mon smartphone un trajet Strasbourg-Paris en covoiturage. Je ne veux pas galérer demain et risquer d’arriver très tard un dimanche soir pour bosser le lendemain.
Après avoir grillé encore un moment au bout du parking, un cardiologue londonien arrête à ma hauteur son 4X4 Volvo de luxe. Je contourne le véhicule et grimpe sur le siège de gauche. A l’arrière, les enfant regardent chacun leur film sur des écrans intégrés aux sièges. La famille rentre chez elle après un séjour en Toscane. Madame qui n’aime pas trop la route a pris l’avion, elle appelle au téléphone pour dire qu’elle est bien arrivée. La conversation en « main libre » emplit l’habitacle ce qui est toujours un peu gênant pour un passager étranger au cercle privé. Le type est fort sympathique. Dans sa jeunesse il a voyagé « à l’aventure » comme il dit. Il a vu la Sibérie, traversé le Kamchatka, la Nouvelle-Zélande… en stop et en bateau. Mon anglais se déride et la conversation va bon train. A mon grand étonnement, il connaît l’île de Rhum pour y avoir été. C’est un endroit cher à mon cœur car peuplé de personnages tous un peu fous et excentriques, et c’était l’un de mes premiers voyages solitaires. Nous parlons ensuite de choses banales : les autoroutes françaises qui selon lui sont les meilleures (j’ai déjà entendu ça) ; moins banales : les découvertes dans le domaine des cœurs artificiels grâce à des cellules musculaires de méduses implantées dans du plastique, dont j’ai entendu parlé récemment. Il semble ne pas être au courant. Etrange pour un cardiologue qui selon ses dires fait des conférences un peu partout dans le monde…
Nous traversons le Rhin près de Bâle et comme il continue vers Strasbourg, j’en profite. Tant pis pour Bâle, je la verrai une prochaine fois. La plaine alsacienne est encore plus plate que je ne l’imaginais. A l’ouest je distingue le premier relief du massif des Vosges et à l’est, la Forêt Noire. Il me parle du bouquin qu’il lit en ce moment, à propos du D-Day et des tensions entre Montgomery, Eisenhower et De Gaulle. C’est plutôt intéressant mais galvanisé par son histoire et sans doute aussi par la qualité de l’autoroute française, il pousse la Volvo jusqu’à 100 miles/hour (160 km/h) ce qui nous amène promptement à Strasbourg.
« Shall you drop me here » dis-je fièrement après avoir préparé la phrase dans ma tête. « I would like to walk a little bit before to reach the center ». Il me dépose à l’entrée de la ville. Je me dirige un peu au hasard vers ce qui me semble être le centre-ville. Quelques canaux traversés et je m’attable à la terrasse d’un troquet bondé, sous un très vieux platane poussant les pieds dans l’eau. Je commande une bière blanche pour me rafraîchir. C’est le quartier qu’on appelle « la petite France ».