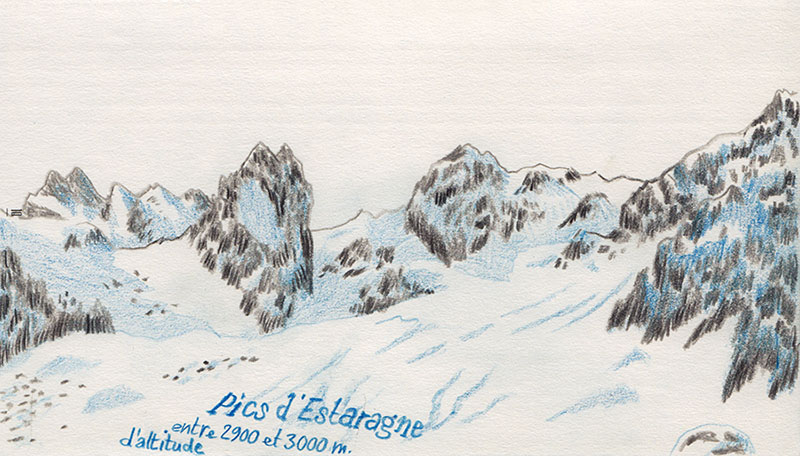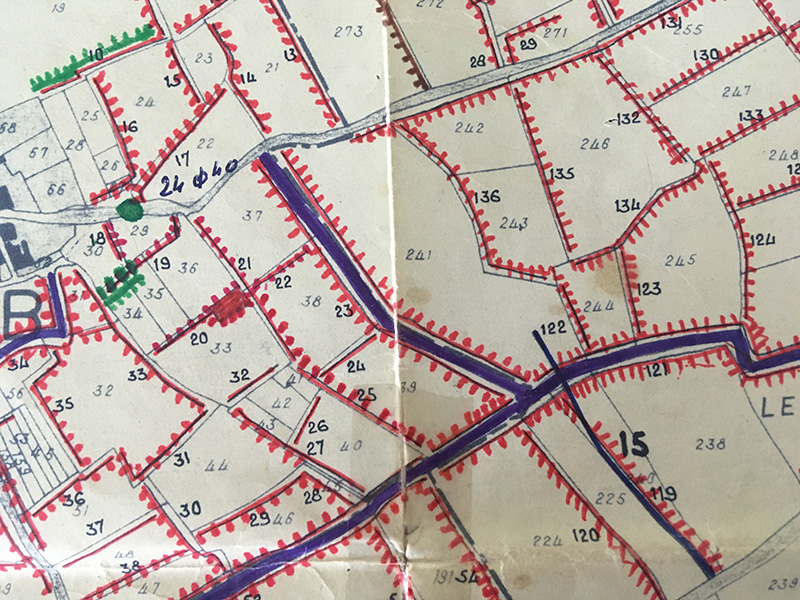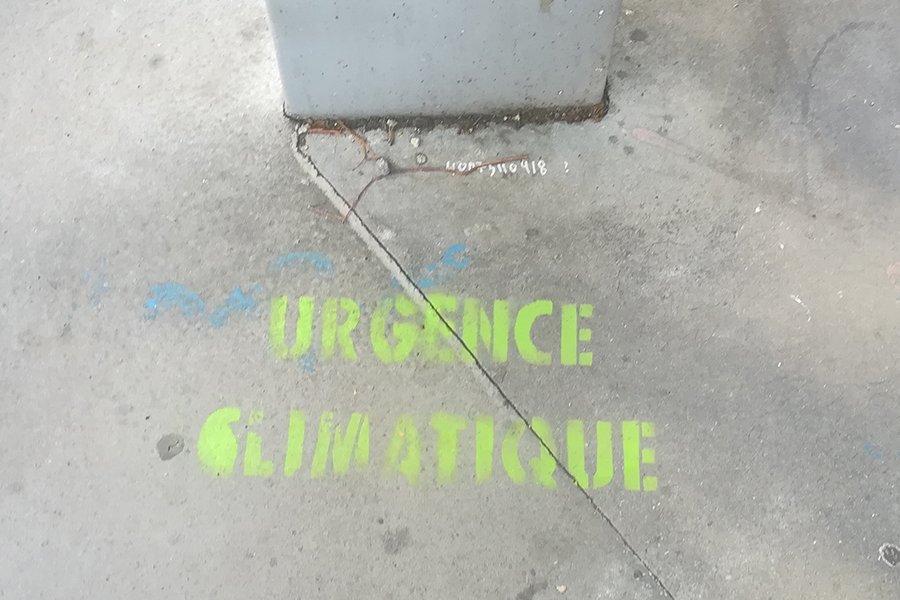Devant mes yeux à la fenêtre du train se succèdent jachères propres, champs de patates encore vierges et déjà irrigués, champs de colza bien avancés maintenant. Et immanquablement, verts et raides, des blés par millions. En Beauce, entre Paris et Orléans, les parcelles sont démesurées. De grosses fermes ventrues jalonnent ça et là cette morne plaine. Alignements d’arbres le long des routes, géants enjambeurs arroseurs, une confrérie d’éoliennes blanches, et beaucoup de lignes électriques portées par d’autres géants de métal. Sur ma gauche, j’aperçois le monorail abandonné sur piliers de béton qui supportait il y a quelques décennies un train expérimental à suspension électromagnétique. Interminable et monotone, il glorifie la platitude angoissante de ce pays.
Avant d’arriver aux Aubrais, le paysage s’urbanise tandis que le train ralentit. Les champs cèdent la place à des bâtiments parallélépipédiques en taule, à des vergers, quelques potagers, des maisons rudes aux toits pentus couverts de tuiles grises crochetées ou oranges autobloquantes. Bouleaux pleureurs, prunus lie-de-vin, glycines, noisetiers gaufrés, cerisiers, érables, tilleuls, émergent des jardins emmurés. Le contrôleur passe dans le couloir du train. La dame à côté de moi n’a pas renouvelé sa carte senior. 34є90 à payer en supplément.
Maisons crépies, aseptisées, dans leurs jardinets de gazon fortifiés de haies résineuses et infranchissables, portiques de balançoires, deux ou trois pommiers, poiriers, un petit lilas blanc et un plus gros, mauve.
13h30. Limoges Bénédictins.
Pays des limousines. Par petits troupeaux, on les voit longer en partant à leur assaut, les flancs verdoyants des hautes collines qui sont le pays de Limoges. Le train s’engage sous le couvert des arbres. On dit les forêts limousines sombres et dangereuses, peuplées de créatures légendaires dont on ne préfère pas parler. Derrière la vitre du train douillet, je ne ressens aucune menace particulière.
Au ciel bleu, des cumulonimbus dilettantes donnent un aspect souriant.
Dans un val plus large qui s’étend à gauche, sont entretenues des prairies humides bordées de haies. Chênes, frênes. Des aulnes au bord du lit. De grands bancs de fleurs blanches les habillent : silènes, gaillets, stellaires, myriades d’étoiles claires qui scintillent sous le soleil maintenant haut.
Tunnels à répétition, ruisseaux vertigineux entaillant les versants, escarpements rocheux où prospère la valériane. Dans les creux loin du soleil, où l’on sent l’eau qui coule mais où l’on ne la voit pas, les noisetiers et les saules étendent leurs membres rameux dont les feuilles sont encore pâles et petites, dentelle fraîche sur fond de vide noir.
14h45. Glissant sur son chemin métallique, le train longe le flanc ouest du massif central et l’on voit l’influence montagnarde conjuguée aux accents du midi s’emparer peu a peu de l’architecture. Lauzes, volets aux tons clairs, pierres calcaire ocres. Nous approchons de Brive-la-Gaillarde. Entourée de coteaux habités, Brive occupe une vaste cuvette dans laquelle nous pénétrons en pressentant le ralentissement du train. Le talus de la voie ferrée est à hauteur des toits ; nous survolons une mer de faubourgs. Terrain de foot, école, cour et platanes, pavillons, jardinets, squares, terrains vagues. Le train s’immobilise. La dame des 34 euros 90 descend.
15h10. Nous nous faufilons maintenant dans le modelé robuste du Périgord. Viaducs, tranchées et tunnels composent un chemin sinueux dans le massif de roche calcaire dure. Les chênes sur les crêtes sont de plus en plus petits à mesure que la couverture du sol s’amoindrit. La forêt recouvre maintenant la totalité du territoire. Soudain la vue s’ouvre sur une large vallée. Sur de nombreuses parcelles plantées de noyers alignés, la terre labourée est d’un brun presque rouge et je me demande ce qui peut être semé dans ces profonds sillons. Des peupleraies régulières complètent la trame agricole. Nous traversons sans s’y arrêter la gare de Souillac qui est pleine de tas de grumes que l’on charge sur des wagons.
16h. Après Gourdon, on arrive en gare de Cahors. Premières tuiles romaines. Le Périgord est jouxté au sud par les causses du Quercy, pays de genévriers, de chênes pubescents et de brebis caussenardes. Le haut-parleur fait entendre la voix d’une vendeuse qui fait sa réclame pour des barres chocolatées, des boissons gazeuses et d’autres denrées comestibles. Elle parle avec un accent du midi moelleux, un peu trainant : l’accent du sud-ouest. Le relief s’aplanit. Des champs de grande taille apparaissent : tournesol, maïs. Nous arrivons à Caussade, un nom qui, pour moi, annonce des senteurs et saveurs gasconnes. Clochers et murs de briques, doux vallonnements fertiles, le bas Quercy est un peu le haut toulousain. Vergers de poires, pêches, nectarines ; vignes sur ceps courts ou grimpantes sur des treilles à hauteur d’homme ; jachères où le pourpre orangé des oseilles flotte en voiles transparents sur le vert franc des herbes hautes. Le train ralentit à l’approche de la gare de Montauban, puis s’arrête dans l’ombre orangée de la halle qui abrite les quais. Les voyageurs qui montent parlent haut et s’adressent spontanément à leurs nouveaux voisins.
17h30 environ. Après le changement de train à la gare Matabiau, j’ai pris place dans le train régional qui m’emmène dans la dernière partie du voyage : Toulouse-Castres, une bonne heure de trajet. Le soleil de la fin d’après-midi est fidèle à lui-même : juste assez chaud pour vous plonger dans une torpeur méditative. Nous nous engageons dans le Lauragais, terrefort fertile et très ancienne campagne céréalière. Pour le moment, nous traversons encore les villages résidentiels de la vaste deuxième couronne toulousaine, mais de grands champs labourés sont déjà présents, caressés par la douce lumière dorée venant de l’ouest. On voit des pavillons groupés en lotissements réguliers, des villas qui émergent de jardins et de parcs dominés par de grands cèdres, des pins parasol et des cyprès. L’ensemble fait malgré tout penser aux images de la campagne romaine et de la toscane.
La voilà. Je l’ai aperçu. Lointaine encore, comme l’image du but de ce voyage, la Montagne Noire a capté l’attention de mes sens inconsciemment tendus vers elle, sans doute parce que mon esprit l’attendait, cherchait sa présence rassurante. S’offrant à ma vue, elle se réduit pour l’instant à une bande d’un bleu velouté presque sans consistance, posée au fond de la plaine, au sud. C’est toujours une émotion de la retrouver, sans doute parce qu’elle est aussi l’image annonciatrice du retour au bercail. Je descend du train à Vielmur. Quelques kilomètres restent à parcourir en voiture pour arriver à la maison. La Montagne Noire est maintenant plus proche, et nous roulons droit sur elle, en direction de Verdalle, sur le piémont.