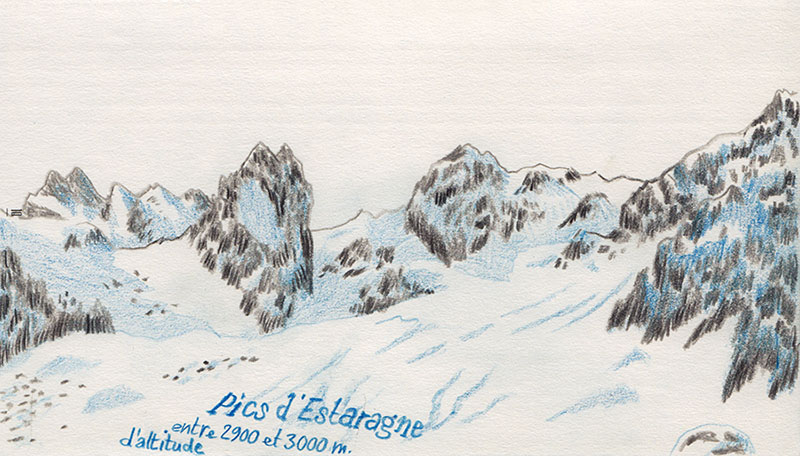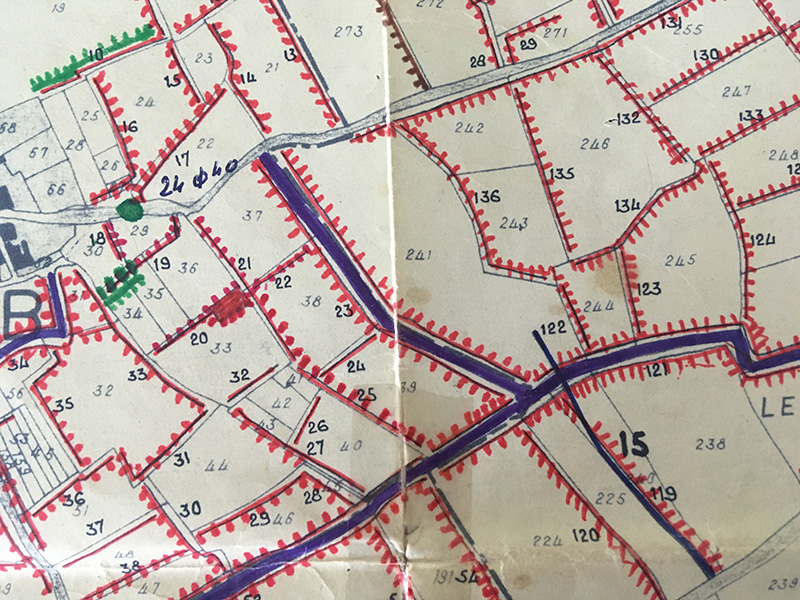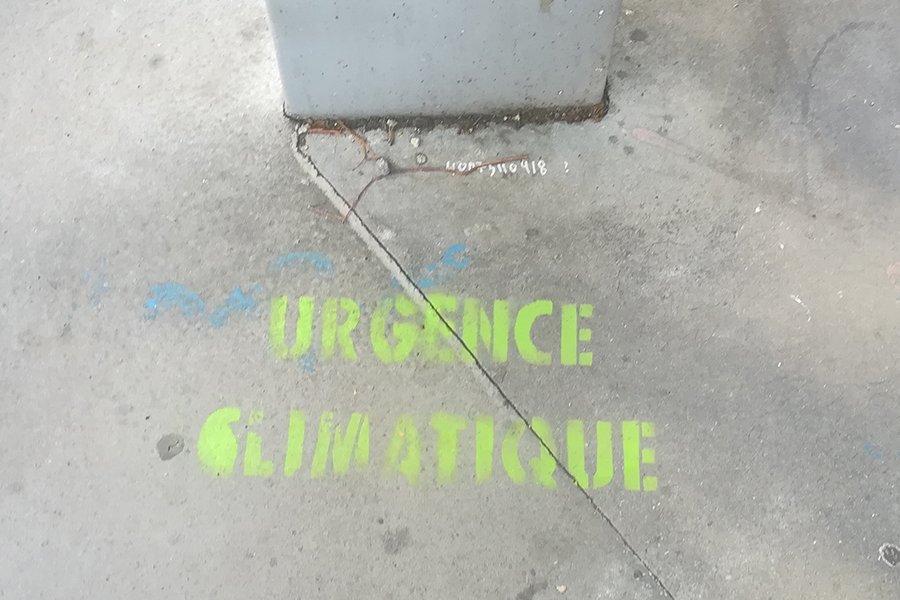En 1948, à l’indépendance, la ville s’est vidée de la moitié de ses habitants, 65 000 arabes sont partis, la plupart par la mer, le port n’était pas loin… C’était la Nakba.
Quelques uns sont restés, cantonnés dans les wadis, qu’une loi britannique avait jusque là protégés de l’urbanisation : Wadi Nisna, Wadi Salib, Wadi Rushmia.
Ils ont bientôt été rejoints par d’autres réfugiés, immigrés d’Europe de l’Est, qui ne trouvaient pas leur place dans la nouvelle société israélienne.
Ils ont ainsi formé une communauté d’exclus dans les vallons, au cœur de la ville.
En 1978, le réalisateur israélien Amos Gitai, alors étudiant en architecture, rencontre cette communauté au hasard d’une promenade dans le Wadi Rushmia. Il sympathise, commence à filmer. Il y reviendra pendant 20 ans. Il en fera une trilogie, deux films en trois temps : Wadi 1981-1991, et Wadi Grand Canyon 2001.
De décennie en décennie, on retrouve les mêmes personnages (Yussuf, Myriam). Certains sont morts (les deux frères roumains), certains sont partis (Skandar le pêcheur), d’autres sont arrivés (immigrés éthiopiens). A travers la chronique de ce lieu, Gitai nous raconte l’envers de la société israélienne.

Wadi Rushmia est un vallon ignoré de la ville, un pli du territoire.
Ayant servi de carrière pour construire la ville, ses flancs sont de hautes falaises calcaires qui accentuent la déconnexion avec le reste du territoire urbain.
Le dessus et le dessous.
Au fond, dans l’oued, des cabanes en planches, les bicoques de fortune des exclus. Comme s’ils avaient été éjectés de la ville, et qu’ils avaient roulé dans le vallon pour se retrouver mêlés les uns aux autres, juifs et arabes, couples mixtes, immigrés…
Au-dessus, le trou est cerné par les crêtes construites, la ville qui pointe son nez, la route qui le surplombe, le skyline des buildings.
Si les hauteurs sont les lieux de la domination, de la surveillance et du conflit, comme l’a si bien montré Eyal Weizman, les fonds sont peut-être les lieux d’un apaisement dans la survie pragmatique, les prémices d’un dialogue, d’un partage. C’est le propos du film.
Le wadi fonctionne comme un microcosme, une réduction du monde, et le protocole de Gitai est imparable : tout en s’imposant une unité de lieu, en réduisant le cadre et le dispositif, il choisit d’étirer le film dans le temps et de l’ouvrir sur la mémoire, l’histoire, l’humain. Tout n’est plus qu’affaire de temps, comme une quatrième dimension de l’espace filmé. Avec lui, on entre par la petit porte dans une archéologie de l’humain. On baisse la tête pour passer sous le figuier, on pénètre dans l’appentis de Yussuf, on rencontre des hommes dans la pénombre, et on plonge par la parole dans leur histoire qu’ils portent comme un bagage, une arme ou une bouée.
Les plans sont fixes, laissent advenir. Gitai intervient peu, juste ce qu’il faut pour faire rebondir la conversation, relancer le plan-séquence pour quelques minutes. Il sait qu’il va trouver son trésor au fond du plan, au bout de ce calme, quand la tension monte à force de silence, quand les personnages finissent par se sentir obligés de dire quelque chose, de continuer leur histoire. Alors, ils nous livrent leur vie, les mythes qu’ils ont en eux, et qui s’éteindront avec eux. La caméra n’a même plus à bouger, elle est déjà là, elle enregistre.
Ces personnages qu’on pourrait si facilement cataloguer de squatters ou de marginaux vus de loin, depuis le haut du canyon, se révèlent être les descendants d’une grande histoire, de grandes lignées, mus par des valeurs inébranlables, une destinée.
Noblesse et dénuement. Dignité et indigence. Pauvreté des corps, indigence de l’habiter, mais hauteur d’âme, pureté de la parole et du souvenir.
Le XXème siècle défile sous nos yeux, l’histoire d’Israël et des Palestiniens, ces horreurs débitées calmement sous le soleil. Chassés de leur propre pays, spoliés, battus, ils ont trouvé refuge ici, dans ce paysage d’après le drame. Ce vallon de cocagne semble avoir été fait pour ceux qui ont vécu le pire.
A la violence des épisodes passés répondent la douceur de la lumière littorale, la brise qu’on sent monter de la mer, l’environnement végétal qui les enveloppe, les petits luxes dérisoires dont ils s’entourent, attributs d’un mode de vie éminemment méditerranéen.

Au cœur du film, la question du vivre ensemble : est-ce qu’on y croit, est-ce que c’est assez fort ?
Skandar et Myriam, le pêcheur arabe marié à la Juive de bonne famille, l’amour à l’état instable.
Myriam est venue de Hongrie à la création d’Israël.
En 1981, elle croit à l’amour avec un Palestinien, et n’y croit plus en 1991.
Gitai film l’avant et l’après.
Ils ont tenté l’impensable, ils se sont aimés malgré leur famille, et finalement se séparent, se déchirent, Skandar est parti entre-temps (mort ?), la maison est détruite et les rancœurs sont à vif.
Myriam, revenue de tout, bascule de l’autre côté, dans le ressentiment envers les Arabes.
La logique communautaire a eu raison de leur amour fou.
Et au fil des trois épisodes, tout est revenu dans l’ordre des choses.

Cet effacement progressif d’une petite communauté qui a cru au mélange, on la lit aussi dans les transformations du vallon lui même, qui est la toile de fond de tous ces récits.
Les trois films montrent La lente évolution d’un lieu qu’on cultive, qu’on délaisse, et dont on finit par être chassé. Trois états du wadi : le wadi jardiné (1981), le wadi enfriché (1991), et le wadi arasé (2001).
Le premier volet s’ouvre sur un champ de fèves.
Yussuf et sa femme cultivent le fond de vallon.
Potager modeste et sans contours, au plus près de la maison, ajusté sur ce que peut faire un homme.
Enclos pour les chèvres, quelques poules. Le tout sous un gros figuier, qui identifie le foyer.
La cueillette aussi : il ramène des bouquets d’aromatiques des décombres avoisinants, sa femme glane au couteau des pissenlits et des salades sauvages dans les coins où la terre est plus profonde.
De son côté Myriam s’est entourée d’arbres : figuier, caroubier, amandier, olivier.
Elle gratte la surface du sol à leur pied pour désherber et retenir l’humidité.
Maraîchage, arboriculture, cueillette : ici, on reproduit l’agriculture comme il y a bien longtemps, une forme d’archaïsme en pleine ville.
Le rapport qu’ils ont à ce vallon est à la fois guidé par la nécessité – construire pour s’abriter, cultiver pour manger, ramasser du bois de chauffage – mais aussi par le plaisir et le raffinement, comme un luxe dans le dénuement, un baume : jouir de l’ombre, mener la vigne en treille, rassembler des agrumes dans une coupe. Les fleurs dont on se pare, l’aromatique qu’on froisse dans ses doigts, la mauve qu’on protège, le savoir des plantes.
Quand il y a du jardinage, il y a de l’ancrage, et de la confiance.

En 1991, les choses sont déjà beaucoup moins claires. Les falaises sont moins nues, la végétation poursuit sa reconquête.
Dans ce qui apparaissait comme un éden, on s’aperçoit vite que jardiner est aussi un combat : les chats sont des alliés, les chiens sont des ennemis.
On se bat contre les chiens sauvages, les vipères, les ordures.
“Quand il n’y a pas de plantes, il y a des ordures” dit Myriam, qui avoue avoir peur des chutes de pierres.
Cette deuxième lecture du site amène une ambivalence troublante.
C’est à la fois une décharge et un éden, un enfer et un paradis.
La luxuriance foisonnante de la végétation rudérale a quelque chose de suspect.
Est-ce un état de nature, une carrière abandonnée, ou une ruine antique ?
Poubelle et jardin à la fois, vestige et urbanisation, nature et anthropisation.
On ne sait plus vraiment si cet environnement est le fruit du laisser-faire ou le résultat d’un outrage.
Pour la première fois, les ruines apparaissent.
“Trois mille personnes ont vécu ici, raconte un témoin, et maintenant toutes les maisons sont en ruines”.
Restent les eucalyptus dans le vent, et les épis dorés des graminées expansionnistes.
Au-delà du visible, le paysage se gonfle de tout ce qui s’est passé avant, de ce qui aurait pu arriver, et de ce qui vient après, qui est déjà en germe.

En 2001, les choses se précisent : le wadi est en chantier, toutes ces histoires vont être englouties par les bulldozers, ensevelies sous la piste de chantier qu’on a remblayée sans ménagement par dessus le terrain naturel.
Des accotements de la piste émergent des rebuts urbains qu’elle a charriés comme les moraines d’un glacier. Elle a pris la place du potager de Yussuf, là où il cultivait ses fèves. Il ne reste que son enclos, frêle refuge de planches et de tôle ondulée en sursis, où vit encore sa famille qui s’est élargie (il est devenu grand-père).
La poussière recouvre aussi son figuier, le vent soulève le sable, le son est saturé des crissements suraigus de la roche qu’on scarifie.
Yussuf se retrouve face aux bulldozers. Encerclé, acculé, il continue à glaner du bois mort dans les décombres.
Il grimpe dans les éboulis, remblais bennés à la va-vite, gratifiés de quelques cyprès colonnaires dispersés esthétiquement dans la pente.
Son ascension le mène à un centre commercial en construction ouvrant sur le wadi, par un niveau semi-enterré qui abrite un luna-park sur le thème du Grand Canyon (!), qui donne son nom au troisième volet de la trilogie.
A partir de là, le wadi n’est plus qu’un canyon de cinéma, le film se change en western, et Yussuf en Indien.
Complètement déboussolé, il entre dans le mall, il erre, comme un animal dont on aurait détruit l’habitat, l’écosystème.
Fin de la trilogie.

Amos Gitai n’a pas tourné de quatrième volet, et pourtant l’histoire se poursuit.
Le mall construit mystérieusement en tête d’un vallon désert, s’est retrouvé dix ans plus tard au centre d’un nœud autoroutier stratégique.
les vallons d’Haïfa, épargnés au XXème siècle, se sont offerts au XXIème comme le réceptacle idéal pour des nappes de flux routiers en spaghetti générés par l’urbanisation.
Wadi Rushmia est devenu le centre d’un système de tunnels en T pour desservir le centre-ville sans contourner la montagne.
Des tunnels à péage à 300 millions de dollars, dont le projet s’est avéré presque contemporain du film : conçu dans les années 90, construit par les Chinois dans les années 2000, livré en 2010.
Ouvrages d’ingénierie pharaoniques, échangeur suspendu, viaducs fondés dans la roche déjà mise à nu des anciennes carrières, rampes vertigineuses, soutènements étagés, prouesses techniques,…
Les ingénieurs peuvent se féliciter de cette opération, qu’on ne peut s’empêcher de voir comme l’éradication planifiée d’un saltus urbain suspect, une manière de fermer définitivement la parenthèse, comme s’il s’agissait de punir ce lieu.
Les viaducs semblent avoir été multipliés ici pour piétiner plus efficacement ce lieu sauvage qui s’inventait une alternative, quelque part au détour des années 80.

On a beaucoup écrit sur le paysage d’Israël, l’aménagement du territoire comme outil de contrôle et de pouvoir.
On sait tout des relations incestueuses entre le militaire et l’urbaniste.
La sophistication effarante des tactiques de domination spatiale, des plus évidentes (colonies, checkpoint, barrières de sécurité,…) aux plus subtiles (zonages réglementaires, stratégies sur le temps long, hydrographie,…).
En parallèle, il y a aussi toutes ces traces historiques surinterprétées, le paysage de la rédemption, les reboisements sponsorisés, le storytelling territorial.
Les deux tendances convergent vers une obsession aménagiste, schizophrène et masochiste, qui bafoue la géographie au nom de l’amour de la Terre sainte et n’aboutit qu’à un saccage du territoire, lentement mais sûrement. Ce sont des choses établies.
Mais en creux de ce paysage surimposé, il y a tout ce qui a été effacé, les oubliettes du territoire, tout ce qui n’avait pas sa place dans le récit de cette nation en construction, et qu’on a préféré balayer sous le tapis. L’accumulation de ces espaces fantômes finit par être vertigineux. Wadi Rushmia en fait partie.
Faut-il croire Myriam quand elle nous dit :
“Peu à peu, tout tombera dans l’oubli (…) C’est un livre refermé, il vaut mieux ne pas s’en souvenir (…) comme on dit : “le silence est d’or”. Ce n’est pas la peine de déballer ces choses-là. La terre a enseveli tout ça, c’est bien ainsi.”
Les images sont extraites des films d’Amos Gitai :
Wadi | 1981 | Documentaire | Durée 40’’ | 16 mm | Couleur
Wadi, dix ans après | 1991 | Documentaire | Durée 97′ | 16 mm | Couleur
Wadi Grand Canyon 2001 | 2001 | Documentaire | Durée 90 | Vidéo | Couleur
Images additionnelles : http://il.worldmapz.com et http://carmelist.livejournal.com