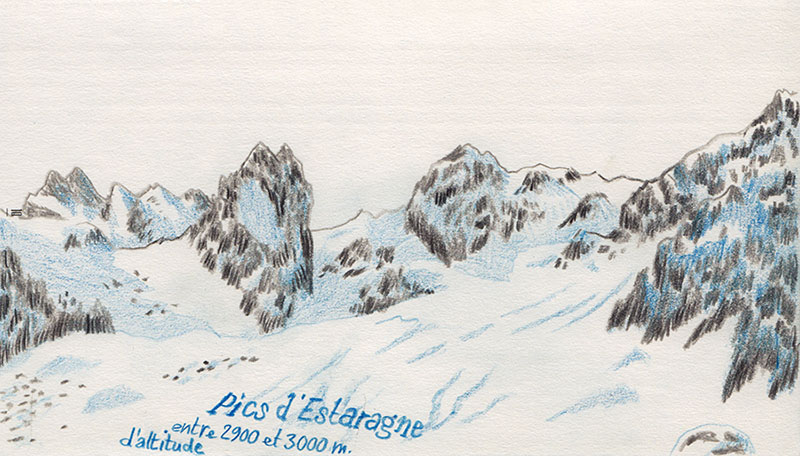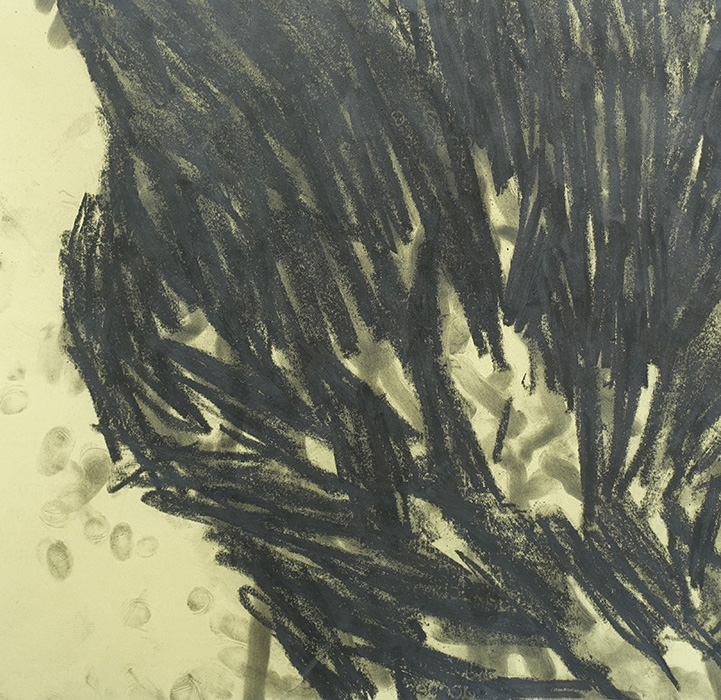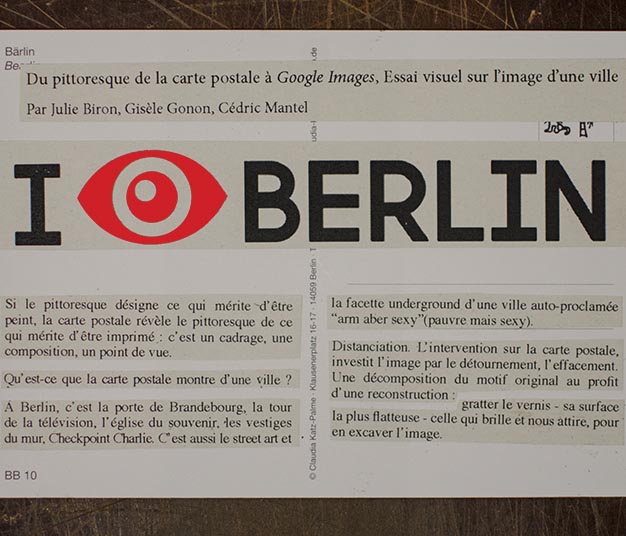Quelques remous blancs, le bruit de l’eau qui chute à l’infini avant de reprendre son large cours, une fine pellicule liquide que venaient aussitôt déchirer des îlots de cailloux émergents. Le soleil envoyait ses rayons de manière si oblique que mon ombre et celle des arbres étaient immenses sur la rive, la pelouse fraîchement tondue du terre-plein au milieu de la route était blonde au lieu d’être verte.
Tout près de moi, des voix d’hommes. Deux pêcheurs étaient au milieu du fleuve. Ils flottaient et bavardaient tout en enroulant leurs moulinets, assis dans des fauteuils gonflables comme des papis au coin du feu, les jambes pendantes dans les cuissardes. Deux jeunes hommes, peut-être même deux grands enfants. Ils avaient dû, bien mieux que moi, assister depuis leurs sièges flottants au lever du jour, et voir ce moment où l’eau noire et froide s’animait, radieuse et vibrante, sous les rayons d’un soleil naissant.
Je longeais de grandes prairies fumantes, l’humidité de la nuit lentement s’évaporait. Dans la lumière diffuse, des plans du paysage se détachaient. Tout ce qui ne l’était pas d’habitude était visible, les toiles d’araignées et les pollens suspendus aux herbes, la rosée partout s’accrochait. J’entrais peu à peu dans les gravières. Je les avais imaginées comme une sorte de Camargue ouverte et rase. Mais les rideaux d’arbres nombreux et la végétation épaisse des saules, des herbes hautes et de la renouée du Japon qui partout dressait ses tiges et ses larges feuilles luxuriantes me faisaient plutôt songer à cet instant aux tropiques et aux mangroves. Sur les bords du sentier, les chatons des saules s’étaient accumulés en une écume cotonneuse et blanchâtre, un gros scooter esseulé attendait sur un parking de sable.
J’avais dû tourner en rond sans m’en apercevoir, puisque je retrouvai dans le sable les traces du passage de mes roues. À force de méandres, une sorte de lac intérieur se détachait à cet endroit de la gravière. Sur ces eaux calmes étaient regroupés une centaine de cygnes. L’eau entière se couvrait de brumes parmi lesquelles glissaient les oiseaux. Ils ne faisaient pas de bruit. Ils ne m’avaient sans doute pas vue ou peut-être qu’ils s’en fichaient. Peut-être étaient – ils encore endormis.



Toute trace de l’aube était effacée quand j’entrai dans Roanne, il commençait à faire chaud. Le fleuve, dont j’allais désormais remonter le cours à pied, était lisse et large, fendu bientôt par le passage d’un kayak. Il fallut franchir un pont avant de rejoindre à nouveau le chemin de halage qui se situait à mi-pente d’un versant maçonné sur toute sa hauteur, entre la ville et le fleuve. En contre–haut, un homme et son chien. En contrebas, deux pêcheurs, une tente et une barque équipée d’un sonar. À mon niveau un promeneur.
Ces quais m’en rappelaient d’autres que j’avais fréquentés souvent, ceux beaucoup plus irréguliers, faits de gros pavés carrés et polis qui plongeaient vers la Loire à Chalonnes. À l’endroit où j’avais grandi. Des quais et des enrochements de schiste qui se laissaient entièrement découvrir ou recouvrir selon les variations du niveau de l’eau. La Loire que j’avais connue enfant était beaucoup plus mouvante, son eau d’apparence plus épaisse était parcourue à sa surface d’une multitude de tourbillons. On nous disait que si l’on était pris dans l’un d’entre eux, il fallait se laisser partir au fond afin de mieux pouvoir en sortir. Il y avait régulièrement des accidents et des noyades car les piles du vieux pont de chemin de fer provoquaient une série de remous et de courants dangereux. Et aussi les pieux de bois qui à certains endroits resserraient le cours de l’eau pour le rendre plus profond.
La Loire ici me semblait particulièrement docile, c’était pourtant la même eau, juste un peu plus près de sa source. J’avais rejoint un chemin creux et frais qui longeait des jardins. Une équipe de boulistes était affairée à ratisser le fin duvet blanc que les chatons des peupliers avaient déposé sur la piste de jeu. L’été approchait, la saison de boule allait bientôt battre son plein.




J’émergeai à hauteur de la route départementale. Je savais que j’entamais là une assez longue marche prise entre les rails de sécurité et le talus abrupt et boisé qui m’empêchait d’approcher le fleuve. J’entamais la traversée des quartiers résidentiels et le long cortège de ces pavillons, dont les formes marquées par les époques et les modes variaient.
Je pouvais voir le fleuve en contrebas quand le rideau de végétation s’interrompait ou qu’il se faisait plus diffus, un long ruban vert dont les ridules brillaient au soleil. Sur la rive opposée, d’assez grosses maisons jouaient les villas, leurs jardins étaient perchés dans le coteau. Le rideau d’arbres s’interrompit au niveau d’un escalier escarpé qui plongeait vers le fleuve, il était doublé d’une échelle de crue. J’entendais à nouveau les voix de deux pêcheurs qui, en aval, barbotaient dans leurs cuissardes, la canne tendue au-dessus de l’eau. Deux hommes, deux amis, deux pêcheurs. Les femmes étaient plus que rares au bord de l’eau.
À l’endroit où je vivais enfant, le cours de la Loire était immensément large, si large qu’il y avait des bras, des ponts et des îles, dont l’une grande comme un village. L’hiver, l’eau inondait une grande partie de l’île, recouvrant les cultures, les pâturages et les caves des habitations. Les habitants se déplaçaient alors en barque. L’été, l’eau était si rare que se dégageaient d’immenses plages de sable couvertes d’une très légère croute de vase séchée qui craquait sous la moindre pression. On nous disait que ces bancs de sable pouvaient à tout moment disparaître, aspirés par des courants souterrains. Nous nous baignions alors avec cette crainte constante, dans une eau chaude et sans profondeur. Nous marchions sur les mains la tête hors de l’eau avec l’idée peut-être que sous le poids moindre qu’exerçaient nos bras, les bancs de sable s’effondreraient moins.
Ici, j’hésitai un peu à entrer dans l’eau car les rochers étaient couverts d’une pellicule noirâtre de vase et d’algues séchées, mais l’eau semblait claire à condition de ne pas remuer ce dépôt. Je fus surprise qu’elle fût si glaciale, le souffle coupé, je fis quelques brasses. Je sentais sous moi toute l’épaisseur de la masse noire et profonde du fleuve et je ne pouvais m’empêcher de penser avec effroi à la multitude et la monstruosité des poissons qui y circulaient. La presse locale publiait régulièrement des photos de brochets, de carpes obèses, de silures énormes dont je savais qu’ils avalaient parfois des canards ou des pigeons.



J’avais presque atteint le barrage. Je déjeunais sous la voûte d’un saule, en contrebas de l’ancien pont de Villerest. En face, dans le flanc du coteau s’ouvrait une carrière. Un amoncellement de murs, de roches, de grues, de porte-à-faux, tous couverts de la même poussière rose qui rendait de loin difficile de déterminer ce qui était du rocher ou non.
Des voix me parvenaient depuis une auberge située au-dessus de moi, depuis les tables couvertes de nappes en plastique lie de vin, sous les énormes tilleuls aux branches desquels pendaient les guirlandes que le soir on allumait. À 12 heures précises étaient arrivés les premiers clients, des familles, des bandes de copains de moins de 30 ans, des doublettes de mamies, des jeunes couples avec et sans bébé. Et tous mangeaient une friture de grenouilles, attablés à quelques centaines de mètres en aval du barrage, inconscients ou insouciants en apparence de la présence de cette eau qui pesait de tout son poids sur la muraille.
Je ne pouvais m’empêcher de voir en pensée le barrage se fendre, se rompre et soudainement lâcher, de voir la déferlante d’eau venir sur nous et tout emporter, à rebours de ce que j’avais parcouru depuis l’aube. Emporter les mangeurs de grenouilles et les guirlandes, emporter les quartiers pavillonnaires, les boulistes, les pêcheurs et leurs fauteuils flottants, emporter les cygnes qui, peut-être, pourraient s’envoler à temps.
Une fois ce barrage passé, c’était la plage. Soudain les berges douces, les pelouses tondues, les étendues de sables. Soudain les pontons jetés sur l’eau, les bouées, les canoës gonflables. Les groupes de jeunes filles étendues sur les longs draps de bain, les groupes de garçons qui hurlent et sautent sauvagement dans l’eau depuis les promontoires rocheux. Les familles un peu à l’écart sous les arbres, les hommes assis sur les glacières et les quelques solitaires qui après une courte baignade, font la sieste et bronzent, le regard et l’oreille en embuscade. Les sons mêlés des cris, des moteurs des scooters et des bateaux. Le soleil à la verticale.
Un groupe de filles s’embrouillait avec un groupe de garçons pour savoir s’il fallait se mettre à l’ombre ou en pleine lumière, avant de faire tomber les robes et les chemises sur des bikinis hyper ajustés. Il y avait bien sûr la jeune beauté et la peau de rousse plus timide qui rosissait à mesure que sa copine prenait un teint hâlé, et celle qui parlait fort, celle qui n’avait peur de rien et surtout pas de l’importance de ses fesses et de ses seins. Les garçons, mis à part le leader qui gonflait à grand coup de pompe son canoë, étaient plus discrets. L’un d’entre eux tentait en boudant de s’opposer au chef de la bande qui s’en foutait.



Lorsque j’embarquais sur le bateau, il faisait encore très chaud. Mais l’eau qui à chaque mouvement courait le long des pagaies vers l’intérieur du canoë vint rapidement me rafraichir. Depuis le milieu du fleuve je me sentais loin, les bords, la terre, étaient tenus à distance et je pouvais les regarder comme l’on regarde un décor, avec le recul nécessaire. Les clameurs de la plage de Villerest se faisaient plus étouffées et les bateaux à moteur un peu moins nombreux. Je pouvais sur mon embarcation entrer dans les bras du fleuve, les replis des anciennes gorges que la construction du barrage avait inondés. Des endroits à l’isolement complet que seul le fleuve permettait d’atteindre, des endroits presque immobiles, où la végétation emmêlée à l’eau composait des tableaux que j’imaginais être la première à découvrir. Dessous, quelque part sous la vase, sous les algues et le cortège des poissons, se trouvaient des ruines d’anciennes fermes, d’anciennes maisons que la mise en eau avait englouties. On pouvait parfois les revoir lorsqu’à de rares échéances on vidait le lac en laissant fuir le barrage. Et ce devait être surtout d’immenses plages de vase qui se dégageaient sur les bords et qui craquelaient sous l’effet rapide du soleil, pendant que toute l’eau et tous les poissons se réfugiaient au fond du chenal, retrouvant le lit étroit et sinueux qui était son lit originel. Et l’on pouvait, semble-t-il, voir réapparaître des routes, des ponts et des murs, avant d’à nouveau les ensevelir.
J’avais déjà passé plus de 12 heures au contact du fleuve et je profitais à nouveau de sa fraîcheur. Les parois qui nous entouraient étaient boisées, les accès à l’eau peu nombreux, j’essayais mentalement de les cartographier pour pouvoir y revenir. Parfois, soudainement, apparaissait dans le versant ou sur la ligne de crête une maison suspendue qui me faisait jalouser les vues imprenables, la tranquillité de ces habitants qui vivaient ainsi cachés. Et par pur esprit de revanche, je pensais aux brumes épaisses qui devaient l’hiver monter de l’eau et stagner entre les versants.
La journée avait été immense, de l’aube au crépuscule. C’était maintenant le moment où l’eau avant de reprendre son apparence froide et sombre de la nuit, se teintait en même temps que le ciel d’une couleur rosée. Les versants de l’autre côté tombaient dans l’ombre. Il y avait encore un pêcheur, seul sur son bateau, qui s’attardait, absorbé peut-être par le bruit léger de mon canoë que l’eau devait lui porter, intact, tandis qu’il laissait trainer sa canne avec nonchalance. Dès fois que. On ne sait jamais. Peut-être attraperait-il ce soir et sous mes yeux un poisson immense au terme d’une lutte longue et intense, qu’il gagnerait.