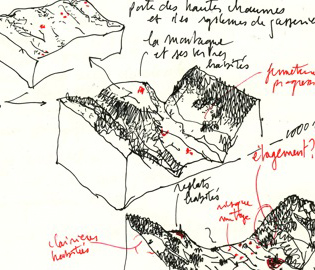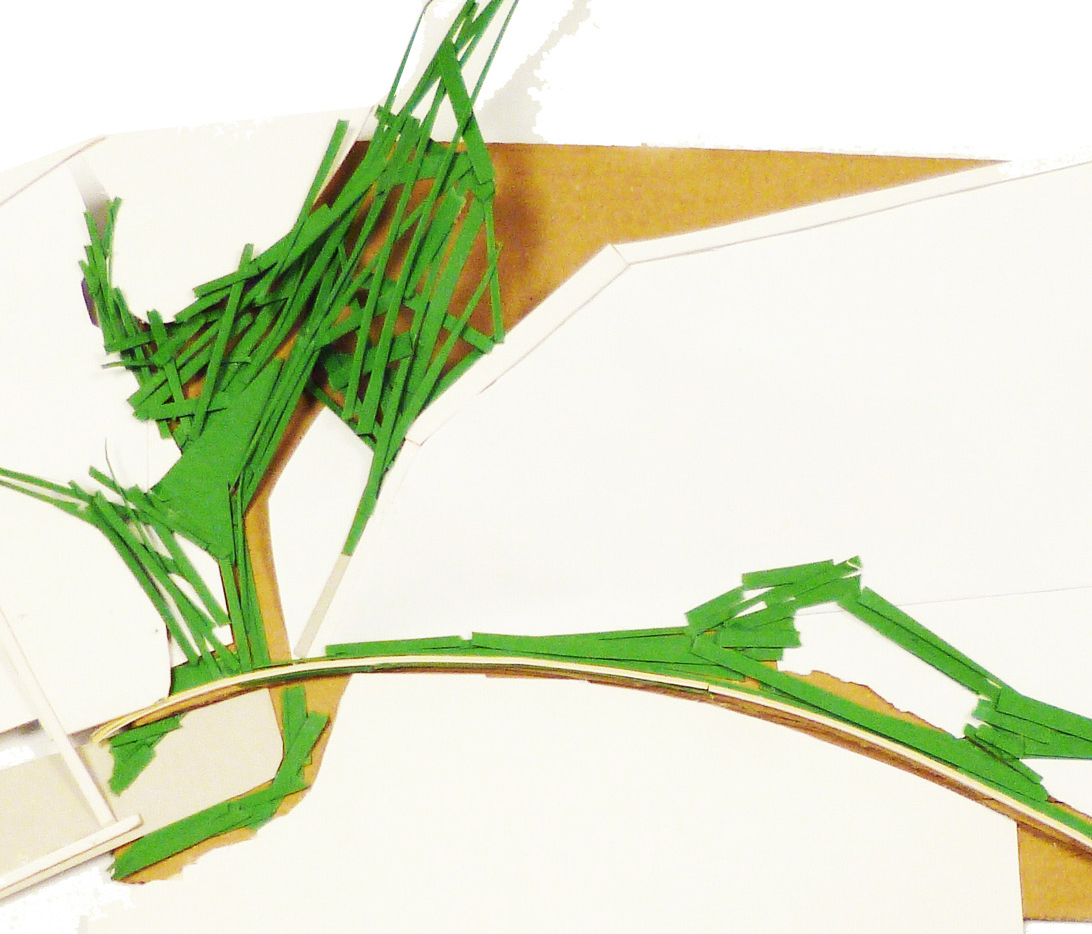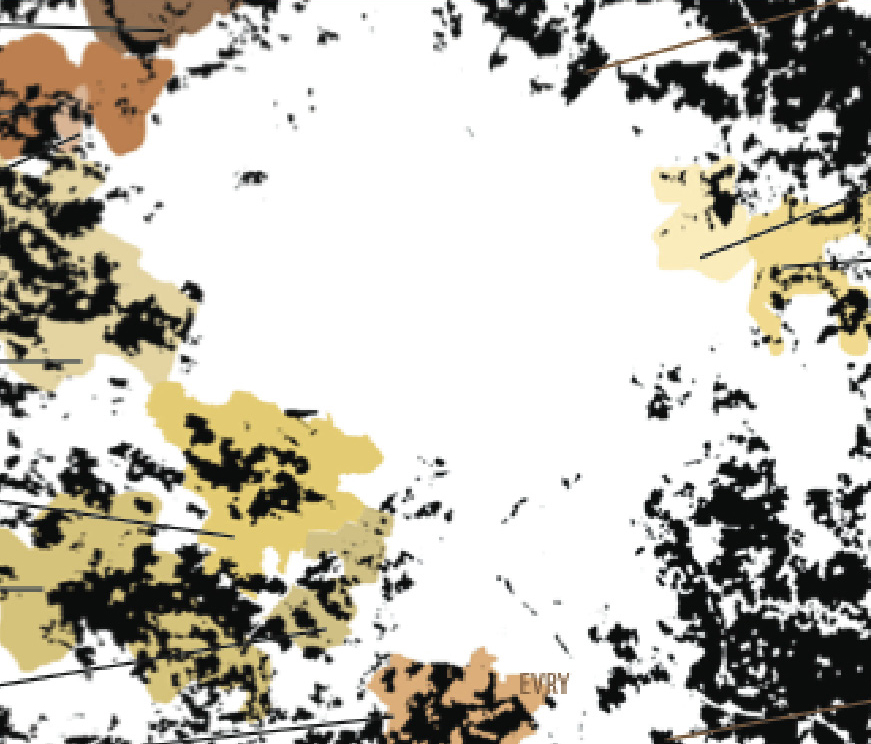Face à ce bougé qui apparaît comme l’immanence même du vivant, on serait en droit de se demander ce que les images viennent faire, et si ce qu’elles ajoutent, qui est un supplément, a une validité. Les images en effet ne sont pas des objets, elles sont toujours image de quelque chose à quoi elles renvoient, elles sont l’équivalent, dans le visible, d’un écho, mais qui aurait une très haute définition et qui, surtout, au lieu d’être éphémère et de se perdre, s’installerait. L’immobilité de l’image est un sursaut qui se fixe et s’installe dans la durée, elle est comme un rivage imprévu de notre expérience du temps. Le monde naturel produit lui aussi des images – les ombres, les reflets – qui ont fasciné les hommes depuis toujours, au point qu’ils en ont fait des archétypes des images qu’ils se mirent eux-mêmes à produire, et qui sont devenues de plus en plus nombreuses. Mais ce n’est qu’avec l’apparition de la photographie – qui est un des signes les plus marquants du renversement induit par l’âge industriel – puis avec le déploiement du numérique, qui en démultiplie les usages, que nous avons atteint à une capacité de production d’images illimitée. Il est courant d’entendre dire que cette multiplication serait une saturation, que nous aurions trop d’images et que c’est en deçà des images que résiderait le domaine du vrai. Mais tout d’abord le vrai n’est pas un territoire, il ne réside nulle part et nul ne réside en lui, il est une qualité que l’on rencontre et qui est comme un éclat. Or cet éclat, venu d’un contact ressenti et vivant, bien souvent, on le voit apparaître aussi sur des images qui en sont la relance et non pas le tombeau. Pour qu’il soit là, cet éclat, il a fallu qu’il y ait un regard – et l’image a cet étrange pouvoir de conserver et de transmettre non seulement une chose vue mais aussi la façon dont elle a été vue, regardée. De telle sorte que les photos entretiennent avec ce qui est, avec le paysage qui nous entoure, une relation singulière : objectives et renvoyant au réel, elles sont en même temps ou du moins peuvent être la trace d’un passage dans le temps : pas forcément celui d’un auteur qui aurait voulu imposer sa marque, mais celui, plus furtif et plus émouvant, de quelqu’un qui passait par là et qui, en s’effaçant lui-même, a su capter ou recueillir l’essence volatile d’un instant. Car ce que nous voyons dans les photos de paysages, ce sont des instants, des coupes légères et nombreuses faites dans l’espace mais aussi dans le temps. Les photos sont comme des copeaux obtenus par un rabot étrange qui n’entamerait pas la surface des choses. Elles flottent, mais leur ligne de flottaison est notre conscience, et c’est un bonheur que de les avoir à son bord : elles ont réfléchi le monde, et nous, nous pouvons réfléchir avec elles.

 © Jean-Christophe Bailly
© Jean-Christophe Bailly